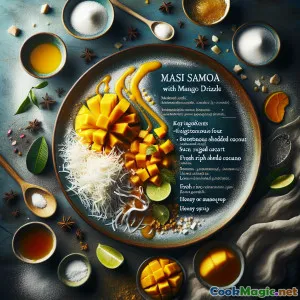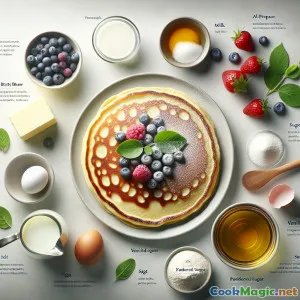Impact des ingrédients importés et indigènes sur les saveurs
15 minute lu Découvrez comment les aliments de base importés et les produits indigènes façonnent les profils de saveurs du Vanuatu, les méthodes de cuisson et l'identité culturelle, avec des éclairages sur l'équilibre, la durabilité et le respect du kastom dans les cuisines modernes. octobre 18, 2025 07:05
La première fois que j'ai traversé le marché central de Port Vila avec un fruit à pain frais glissé contre la hanche, l'air sentait le lait de coco chaud et la terre humide. Il avait plu — l'une de ces rafales rapides insulaires qui laissent tout vernis et lumineux — et les feuilles de bananier sur les étals resplendissaient comme du jade poli. Des femmes en robes à fleurs se penchaient sur des monticules de taro et d'igname, les pesant au toucher, leurs mains aussi expertes avec les racines qu'un guitariste avec ses cordes. Quelque part tout près, quelqu'un venait d'ouvrir un jeune coco; la cassure était nette, le parfum lacté. Un garçon passa en courant avec un sac en papier de tuluk chaud, cette merveille ni-Vanuatu du porc scellé dans une pâte de manioc râpé et cuit dans un paquet enveloppé de feuille. J'en ai acheté un et je l'ai déchiré. La vapeur s'est levée. Le manioc était élastique et légèrement caoutchouteux, la garniture salée-douce avec de la graisse, et tout cela avait, pour moi, le goût du battement de cœur de l'île.
Ce qui donnait sa puissance à ce tuluk ? Certaines de ses parties étaient anciennes : la noix de coco et les feuilles de bananier, des techniques aussi anciennes que les histoires racontées près des feux du soir. D'autres éléments provenaient de l'importation : le manioc, originaire d'Amérique du Sud, était un passager clandestin colonial devenu indispensable. La nourriture du Vanuatu n'est pas un dictionnaire statique de saveurs « indigènes ». C'est une conversation — parfois tendre, parfois bruyante — entre ce qui a poussé ici, ce qui y a voyagé, et ce que les habitants ont choisi d'intégrer.
Dans ce texte, je ne fais pas que tester les saveurs; je les écoute. Les ingrédients importés et indigènes sont plus que des étiquettes; ils forment des étoiles et des courants qui entraînent le repas vers de nouvelles marées. Les enjeux ne sont pas uniquement culinaires. Ils sont émotionnels, historiques et personnels. Ils sont le goût de la terre et de la mer, et l'écho de la cloche d'un navire.
Le goût de la terre et de la mer : les aliments de base indigènes du Vanuatu

Les denrées indigènes du Vanuatu — ou plus précisément, les ingrédients qui y ont pris racine bien avant les circuits de fret du monde moderne — façonnent un palais claironnement minéral, lacté et discrètement luxuriant. Pensez au taro avec ses stries violettes, qui cède à une mastication douce; à l'igname avec une richesse amidonnée digne, une lente éclosion de douceur; au fruit à pain rôti qui révèle un intérieur croquant évoquant la châtaigne et le pain grillé. L'arche cathédrale qui les soutient toutes est la noix de coco: l'eau du jeune coco légère comme un carillon, la chair râpée moelleuse et neigeuse, la crème pressée épaisse comme de la cire molle, tout imprégné par le souffle salé de la plante qui pousse près de la mer.
Dans les villages de Santo, Tanna, Malekula et Ambrym, la nourriture est tirée des fours de terre: pierres chaudes raclées dans le feu et déposées dans une fosse peu profonde, feuilles de bananier superposées comme des couvertures vertes pour accueillir le festin du jour. À l'intérieur de ce berceau, le laplap de taro râpé absorbe la crème de coco jusqu'à ce qu'elle gonfle, les feuilles en dégagent un parfum vert mousseux, et les pierres insufflent la fumée dans les replis. Tout sort avec un brillant qui ressemble à de la résine et qui procure une impression de générosité.
La première fois que j'ai aidé à préparer le laplap dans un village près de Luganville, un ancien guida mes mains comme s'il m'apprenait à écrire mon nom. Nous avons râpé le fruit à pain jusqu'à ce que le bol forme un tas doux, je l'ai salé d'une pincée précautionneuse, puis versé de la crème de coco mélangée avec une cuillère en bois gravée. Il a pressé le mélange sur des feuilles de bananier, lissant le tout avec la paume de sa main dans des cercles concentriques, murmurant sur l'épaisseur — trop mince et cela devient caoutchouteux, trop épais et cela devient collant. Dans le four de terre, il est parti, et quand il en est sorti, il était lisse et tendre, nappé d'encore plus de crème de coco qui avait une légère odeur de fumée et de fougère.
Des ingrédients indigènes — ou profondément enracinés — rythment le tempo de cette nourriture: un tempo assez lent pour que la chair des racines s'ouvre, assez rapide pour que les poissons tirés de la saumure atteignent le feu encore vêtu de mer. Le chou d'île (aibika) tombe en soie; les fougères sauvages évoquent des ravins ombragés et apportent un croquant délicat, frais et concombre. Les noix de nangai, avec leur tonalité beurrée et légèrement résineuse, ajoutent un chuchotement forestier. La saveur n'est jamais forte. Elle est dévote.
Navires coloniaux et étagères du marché : comment les importations sont arrivées

L'histoire des importations au Vanuatu n'est pas une simple trivia sur les chaînes d'approvisionnement; c'est l'histoire du pouvoir, de la survie et de l'improvisation. L'administration du Condominium anglo-français n'était pas un simple trivia sur les chaînes d'approvisionnement; c'était l'histoire du pouvoir, de la survie et de l'improvisation. Des navires arrivaient avec de la farine et du poisson en conserve, avec du corned beef, avec du vin et du vinaigre, avec des plantules de cacao, des vignes de vanille et des caféiers qui trouveraient plus tard refuge sur les pentes volcaniques de Tanna.
Les ingrédients importés ont reformé ce que les cuisiniers pouvaient faire, parfois par désir, parfois par curiosité. Le maquereau en conserve a fait son entrée dans les cuisines tant comme commodité que comme nouveauté—une brillance huileuse qui pouvait se fondre dans le laplap pour apporter des protéines lorsque les cochons étaient réservés pour des cérémonies. La farine de blé offrait une texture que les racines insulaires n'apportaient pas: élasticité, levée, craquant. Aujourd'hui, à Port Vila, vous pouvez acheter une baguette qui se casse en éclats sous vos dents, puis vous asseoir pour une assiette de poisson des îles dans une crème de coco. À L’Houstalet, une institution à l'influence française, le bœuf de Santo se pare d'une sauce au poivre, mariage entre les pâturages du Vanuatu et le palais parisien.
Toutes les importations ne sont pas françaises, toutes les influences coloniales ne le sont pas. Les épiceries chinoises à Vila vendent de la sauce soja et de l'huile de sésame, ajoutant de nouvelles arêtes aux sautés de chayote et d'aibika. Le piment — une plante américaine devenue mondiale — a trouvé un foyer prêt sur les langues locales; quelques gouttes de son feu réveillent les racines amidées. Des tomates en conserve peignent un ragoût rapide en écarlate lorsque le jardin est maigre. Le marché montre tout cela: les bananes et le fruit à pain côte à côte avec des sacs de riz.
Ces éléments changent la dynamique: une assiette de taro peut devenir palpitante avec un éclaboussement de sauce chili-lime. Faire d'un laplap avec du maquereau en conserve une richesse huileuse et une salinité métallique donne une nouvelle brillance à la crème de coco. Un chip de fruit à pain frit se casse bruyamment dans la bouche, ses bords dorés apportant la saveur d'un amidon caramélisé que le fruit à pain cuit à la vapeur n'apporte pas.
La clé est que les saveurs importées affûtent et intensifient; les saveurs indigènes s'enracinent et s'enlacent. Ensemble, elles peuvent créer un chœur.
Une histoire de deux laplaps : variations natives et importées

Le laplap est plus qu'un plat; c'est une carte du goût d'un peuple. Permettez-moi d'offrir deux versions que j'ai cuisinées avec des amis à Port Vila pour comprendre l'impact des ingrédients.
Laplap A : fruit à pain, coco, chou d'île.
- fruit à pain râpé pressé sur des feuilles de bananier, légèrement salé.
- Crème de coco épaisse battue avec un peu de gingembre frais râpé (cultivé ici depuis des générations, son parfum est citronné et frais).
- Chou d'île (aibika) blanchie, pressée et hachée, puis superposée sur le fruit à pain.
- Enveloppé bien serré dans des feuilles de bananier, cuit sur des pierres chaudes, terminé par un filet de crème de coco fraîche.
Résultat: C'était comme un après-midi refroidi par la pluie. Fruit à pain doux, presque à la crème, la coco qui glisse comme de la soie sur la langue; une teinte légère de chou provenant des greens sans aucune morsure. La fumée s'est insérée discrètement, comme un souvenir plutôt qu'un titre. L'impression générale était sereine, apaisante, nourrissante comme une berceuse.
Laplap B : cassava, maquereau en conserve, poudre de curry, citron vert.
- Cassava râpé (une importation devenue indispensable) étalé sur des feuilles de bananier, légèrement plus salé que le Laplap au fruit à pain, car le goût neutre de la cassava apprécie la vigueur.
- Mélangé : maquereau en conserve émietté, une cuillère à café de poudre de curry et des oignons verts hachés (semences importées mais largement cultivées). Une cuillerée de crème de coco pour lier.
- Bien enveloppé, cuit sur des pierres chaudes, puis servi avec des quartiers de citron vert.
Résultat: Un tempo totalement différent. La cassava était plus élastique; le curry parfumait l'ensemble du paquet avec des épices chaudes, et le sel huileux du maquereau créait de petits souffles d'intensité océanique. Le citron vert pressé sur le dessus rend tout lumineux. C'était joyeux, un plat qui danse. Il vous invitait à vous réveiller.
La leçon : les laplaps indigènes privilégient la continuité — textures lisses, crème parfumée, le silence de la fumée. Les laplaps à tendance importée prospèrent sur les contrastes — épices versus crème, sel versus base, acide versus gras. Aucun n'est « meilleur »; ils invitent des humeurs différentes. Le jour où je veux calme, donnez-moi le fruit à pain. Le jour où j'ai besoin de bruit, passez la cassava et le citron vert.